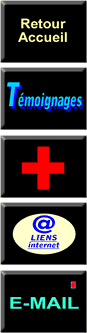
ESSAIS CLINIQUES MUCOVISCIDOSE
A ce jour, 28 essais cliniques de transfert de gène appliqué à la mucoviscidose ont été répertoriés (site web de J. Gene Medicine)
Les vecteurs utilisés sont de 3 sortes
- vecteurs adénoviraux
- AAV
- vecteurs synthétiques
Un essai n'utilise pas le gène CFTR mais celui de l'antiprotéase xl-antitrypsine destiné à réduire les phénomènes inflammatoires lié à la maladie.
Dans certains des essais, les vecteurs sont administrés sous la forme d'aérosol (dont l'essai de phase 1 Transgène basé sur un adénovirus aérosolisé). Les vecteurs synthétiques sont pour l'instant d'efficacité limitée comparativement aux adénovirus et aux AAV. Ils peuvent cependant être réadministrés du fait de l'absence d'immunogénicité associée à ces vecteurs, ce qui n'est pas le cas des vecteurs adénoviraux. Cet obstacle n'est pas levé, d'où la décision de TRANSGENE de ne pas poursuivre ses efforts dans cette pathologie.
Il semble que les AAV représentent l'approche actuellement la plus prometteuse pour la thérapie génique de la mucoviscidose. On sait aujourd'hui que les AAV permettent l'expression du gène CFTR in vivo chez l'animal, notamment le singe. Cette expression est prolongée dans le temps et les administrations répétées sont bien tolérées. Chez l'Homme, 60 patients avaient été administrés avec un AAV-CFTR sans qu'aucun effet secondaire notable n'ait été rapporté. L'administration unique de ce vecteur a permis une expression liée à la dose, et persistante de la protéine CFTR dans les sinus maxillaires, la muqueuse nasale et les poumons. Un essai de phase Il, en double aveugle, est en cours de dépôt par l'équipe de Richard B. Moss à Stanford (USA). L'AAV est prévu d'être administré dans les poumons par aérosol 24 patients doivent être inclus dans l'étude (âge > 15 ans dans un premier temps).
Une autre option consiste à utiliser un traitement à base de gentamycine, un antibiotique capable de rétablir le fonctionnement de gènes inactifs à la suite de mutations stop (ce qui est le cas de mutations affectant le gène CFTR chez les malades). Dans de récents essais sur quelques malades, la gentamycine semble produire un gain de fonction et l'expression de la protéine CFTR chez les malades traités par (Clancy et al. Am . J. Respir. Crit. Care Med. 2001 ; Wilschanski et al. , Am. J. Respir. Cn't. Care Med 2000).
MUCOVISCIDOSE
Note sur l'état actuel des recherches
en thérapies génique et cellulaire
(Robert Manaranche 1 /12 / 2001)
La mucoviscidose est une maladie génétique, autosomique récessive, monogénique, dont la fréquence est de 1/2 000 à 1/3 000. Une personne sur 30 est porteuse de l'anomalie. Le gène localisé, en 1985, sur le chromosome 7 a été identifié en 1989 . Il code pour une protéine appelée CFTR qui intervient dans les mouvements ioniques (notamment pour les ions chlore) à travers la membrane cellulaire. On connaît aujourd'hui prés de 1 000 mutations différentes de ce gène, la plus connue étant une petite délétion deltaF508 concernant un seul acide aminé. Les manifestations de la maladie sont présentes surtout au niveau des poumons (encombrement par du mucus visqueux = cystic fibrosis) ) mais aussi du pancréas exocrine (90% des patients), du foie, de l'intestin etc..
THÉRAPIE GÉNIQUE
Les premières tentatives de thérapie génique (TG) pour la mucoviscidose ont été entreprises dès 1992-93 et il y a eu environ une trentaine d'essais cliniques, certains étant encore en cours. C'est certainement la maladie monogénique pour laquelle le plus d'essais de TG ont été effectués . On a surtout utilisé des adénovirus comme vecteurs mais aussi des vecteurs artificiels. Les expériences ont surtout été conduites par administration du vecteur par aérosol dans les narines.
En France la société Transgène a été le fournisseur de vecteurs (des adénovirus) pour les essais effectués essentiellement à Lyon par le groupe de G. Bellon à partir de 1994. Tous les essais effectués ont été jusqu'ici infructueux pour guérir la mucoviscidose.
Plusieurs problèmes encore mal résolus sont probablement à la source de ces échecs - quelle doit être la cible ?, quel type de cellules faut-il corriger ? Les cellules de l'épithélium ? ou les cellules glandulaires sous-muqueuses ? Les bronches ? ou les petites voies de l'appareil respiratoire : les bronchioles ?
Le renouvellement de ces cellules pose le problème d'applications réitérées et donc des réactions immunitaires.
- quel pourcentage de cellules responsables de la maladie doit-il être corrigé ? - quel type de vecteur est le plus adéquat ? La réaction inflammatoire doit être surmontée, ainsi que la réaction immunitaire. Les adénovirus ne semblent pas les meilleurs vecteurs de ce point de vue. Les lentivirus et les A,AV seraient sans doute plus adéquats mais leur préparation et leur innocuité doit être encore totalement démontrée en conditions voulues pour obtenir les autorisations d'essais cliniques. Les vecteurs artificiels sont encore peu efficaces. Récemment un virus dérivé du virus Sendaï aurait montré une bonne activité de transfert 1 000 fois plus efficace (sur des épithéliums humains en culture), que les virus utilisés jusqu'ici pour traiter cette maladie,
- Comment atteindre les cellules à corriger ? La couche de mucus toujours présente dans les voies respiratoires des malades constitue une barrière difficile à franchir par les vecteurs. Des substances sont aujourd'hui connues pour surmonter cette difficulté. La composition du liquide de la surface des voies respiratoires est différente chez les patients que chez les individus sains et ceci intervient peut être quant au choix du vecteur. Les cellules épithéliales sont difficiles à pénétrer par leur face apicale. Comment les atteindre par la face basale ? Par la voie sanguine peut être, avec les difficultés inhérentes à la voie systémique (passage du vecteur à travers la paroi vasculaire, protéases du sérum etc..). L'atteinte par la maladie d'autres organes que les poumons exigera sans doute de recourir à la voie systémique
Les modèles murins se sont révélés différents au niveau de l'épithélium respiratoire de l'organisme humain, il faudra sans doute rechercher d'autres modèles ou extrapoler à partir de modèles in-vitro.
Conclusion : Des essais réalisés jusqu'ici il reste la démonstration fondamentale de la faisabilité des techniques de TG pour la mucoviscidose et la non nocivité de ces techniques. Les techniques utilisées ne sont pas encore efficaces quant au nombre de cellules corrigées et à la permanence de la correction obtenue. Ces essais n'ont concerné que l'épithélium respiratoire, il faudra aboutir à une correction des autres cellules affectées par la maladie, notamment au niveau du pancréas.
THÉRAPIE CELLULAIRE
Les cellules de l'épithélium respiratoire, ou du tube digestif, sont d'origine endodermique par conséquent des cellules souches de ce type sont nécessaires pour envisager une thérapie cellulaire. A partir de cellules souches pluripotentes il sera sans doute possible de conduire des populations cellulaires à se différencier en cellules des différents types touchés par la mucoviscidose, mais beaucoup de travail reste encore à faire.
Texte envoyé à muconexion par Nonotte barandou.noelle@wanadoo.fr et mis en ligne avec l'aimable autorisation de Monsieur Bernard BARATAUD (AFM)