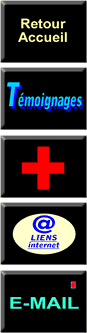
Dons d'organes: l'appel aux vivants
Les organes prélevés sur donneurs vivants représentent à peine 4,4 % des greffes de rein, 6,5 % des greffes de foie et 1,4 % des greffes de poumon." Bernard Kouchner
Chaque année, plus de 200 patients meurent faute d'avoir pu bénéficier à temps d'une greffe d'organe.
Et ce chiffre reste stable en dépit des campagnes régulières pour relancer les dons.
Pour tenter d'y remédier, le projet de loi de révision des lois sur la bioéthique, actuellement en discussion à l'Assemblée nationale, a choisi de faciliter les greffes d'organes à partir de donneurs vivants.
En France, pour des raisons historiques et culturelles, ce type de pratique est marginal. "Les organes prélevés sur donneurs vivants représentent à peine 4,4 % des greffes de rein, 6,5 % des greffes de foie, et 1,4 % des greffes de poumon", a rappelé Bernard Kouchner, le ministre délégué à la Santé.
Avant de noter: "Mais c'est vrai, cette technique n'est pas sans risque: il y a trois décès pour 10 000 donneurs de reins." Récemment, en France, un patient est mort après avoir été prélevé de la moitié de son foie qui devait être greffé sur son frère.
Jusqu'à présent, la loi était restrictive : Seules les personnes ayant des liens de parenté au premier degré (père, mère, frère, soeur) pouvaient donner un organe: dans un couple marié, le don n'était possible qu'en situation d'urgence.
Le projet de révision cherche à élargir cette possibilité, non seulement à tous les membres de la famille, mais aussi aux personnes ayant un lien "stable et étroit" avec le futur receveur.
Chances : "Pourquoi nous proposons ces dispositions?
Pour accroître les chances des patients, mais aussi pour adapter la loi aux évolutions sociales, et sortir du simple lien familial où des pressions peuvent s'exercer, a expliqué Bernard Kouchner.
La notion de lien étroit et stable a pour but d'éviter la dérive commerciale
" Un amendement de la Commission spéciale sur la bioéthique a cherché à ajouter le qualificatif "affectif" à ce lien.
Françoise de Panafieu (RPR, Paris) s'est montrée hésitante devant cet élargissement : "La sagesse consisterait à s'en tenir à une définition élargie de la famille, en supprimant la notion d'urgence pour les conjoints, et en ne dépassant la notion de parenté qu'au profit des seuls concubins.
Le Conseil d'Etat a souligné qu'une extension des donneurs sur le seul fondement du lien affectif pose des problèmes juridiques majeurs". "Nos lois sont assez encombrées de termes inutiles pour qu'on ne rajoute pas du vague avec ce mot "affectif"", a surenchéri Marie-Thérèse Boisseau (UDF, Ille-et-Vilaine).
Mouvement d'humeur d'Yvette Roudy (PS, Calvados): "Je ne comprends pas qu'on refuse d'introduire un peu de sentiment dans une loi."
Finalement, le mot "affectif" n'a pas été adopté, seul étant retenu le caractère stable et étroit du lien pour permettre un don d'organe de son vivant.
Jean-François Mattéi (DL, Bouches-du-Rhône) n'a pas voulu s'arrêter là. Souhaitant que l'on donne aussi un signe fort pour relancer les greffes d'organes à partir de personnes décédées,
il a demandé que chacun, entre 18 et 25 ans, soit interrogé par le médecin généraliste pour savoir s'il souhaite ou non donner ses organes à sa mort.Refus signalés : La réponse serait ensuite inscrite sur la carte Vitale de la Sécurité sociale.Amendement refusé par le gouvernement, qui ne veut pas "bouleverser" le système actuel dans lequel le registre national des refus permet déjà aux personnes qui se refusent à un tel prélèvement de se signaler en s'y inscrivant.