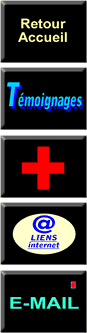
CIRCULAIRE DHOS/O/DGS/SD5/2001 n° 502 du 22 octobre 2001 relative à l'organisation des soins pour la prise en charge des patients atteints de mucoviscidose.
I . Rappel médicalLa mucoviscidose est la maladie génétique grave la plus fréquente en Europe.
Le nombre de naissances concernées par cette maladie est estimé, en France, à 1/3 500 et le nombre de patients vivants atteints de mucoviscidose entre 5000 et 6000.
Il s'agit d'une maladie de transmission autosomique récessive, liée à une anomalie génétique.
Le diagnostic se fait généralement dans les premières années par un test de la sueur. Mais le caractère peu spécifique des manifestations cliniques (digestives et surtout respiratoires) et l'existence de formes à révélation plus tardive peuvent conduire à faire le diagnostic à un âge plus avancé.
Il s'agit d'une maladie évolutive pour laquelle il n'existe pas de thérapeutique curative aujourd'hui, même si des recherches se font dans différentes directions ( thérapie génique, approches pharmacologiques).
Le traitement reste donc symptomatique et vise à intervenir le plus précocement possible par une prise en charge multidisciplinaire comportant, en plus des soins médicaux, une kinésithérapie particulièrement importante et un suivi nutritionnel.
La majorité de ces traitements se fait à domicile. Cette prise en charge multidisciplinaire a permis depuis plusieurs années une nette amélioration de la durée de vie des malades conduisant la majorité d'entre eux à l'âge adulte.
II. La mise en place d'une organisation structurée des soins, définie au plan national est rendue nécessaire par la généralisation du dépistage néonatal et doit permettre d'améliorer encore la durée de vie des patients et leur qualité de vie.
Le dépistage néonatal de la mucoviscidose est aujourd'hui possible en même temps que les autres dépistages néonatals déjà réalisés (hypothyroïdie, phénylcétonurie, hyperplasie des surrénales et drépanocytose).
Il a donc été décidé de généraliser ce dépistage déjà pratiqué dans certaines régions à l'ensemble du territoire national de façon progressive dans les 3 ans à venir, à compter du début de l'année 2002.
Des équipes pédiatriques à l'expérience reconnue doivent parallèlement pouvoir accueillir sans délai, les familles frappées par un diagnostic lourd, alors même que l'état clinique de l'enfant est encore satisfaisant, et mettre en place, le plus précocement possible, les protocoles de traitement et de suivi nécessaires.
Même si les comparaisons sont toujours difficiles entre pays ayant des systèmes de soins différents, la médiane de survie dans les autres pays occidentaux apparaît supérieure à ce qu'elle est en France ( 29,6 ans en 1999), en particulier au Danemark (45 ans). Or, on constate que, dans ces pays, le suivi des patients est réalisé depuis plus de 10 ans sous la responsabilité d'un nombre réduit de centres qui regroupent des compétences multiples, un plateau d'explorations adaptées et une grande expérience clinique.
Avec des files actives de patients par centre (définies par le nombre de patients vus dans le centre au moins 4 fois par an -et dans certains pays une fois par mois-) supérieures à 50 voire à 100, le regroupement des moyens humains et matériels ainsi que l'expérience des professionnels permet d'obtenir une prise en charge optimale des patients.
C'est pourquoi, il devient indispensable, parallèlement à l'établissement de protocoles standardisés de repenser l'organisation de la prise en charge des patients en tenant compte de ces informations.
III. Une organisation des soins structurée en réseau avec la participation du patient et de sa famille sous la responsabilité d'un centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose (CRCM), situé en milieu hospitalier.
La mucoviscidose est une maladie évolutive qui va entraîner nécessairement des conséquences physiques, psychologiques, scolaires et sociales retentissant sur le patient mais également sur sa famille.
La diversité des organes concernés ( poumons et sphère ORL, tube digestif, foie et voies biliaires, pancréas exocrine et endocrine, organes reproducteurs...) implique une approche à la fois globale et multi-professionnelle dans des champs de spécialités différents.
La participation de la famille et du patient comme dans toute pathologie chronique est essentielle pour que le traitement toujours lourd et contraignant soit suivi de façon optimale :
prises de médicaments pluri-quotidiennes,
séances de kinésithérapie respiratoire,
séances d'aérosols,
recommandations alimentaires….
La prise en charge du patient peut également nécessiter, à un moment de l'évolution, des soins d'une relative technicité (antibiothérapie séquentielle par voie intraveineuse sur cathéter central à chambre sous cutanée, nutrition entérale, oxygénothérapie) qui peuvent le plus souvent se faire à domicile ou dans un lieu de soins à proximité du domicile ( centre relais ).
C'est pourquoi, la coordination des soins, de l'hôpital jusqu'au domicile et autour du domicile, est un point essentiel de l'organisation générale de la prise en charge.
Les décisions stratégiques qui conduisent à ces soins doivent être prises par une équipe pluridisciplinaire qui connaît bien le patient et sa famille ainsi que leur capacité à assumer ces traitements et qui, par son savoir faire, sera à même de prendre les meilleures décisions thérapeutiques.
Il s'agit de mettre en place et de formaliser un réseau de prise en charge avec la participation du patient et de sa famille, pour optimiser l'ensemble des moyens qui peuvent contribuer à offrir à ces patients le meilleur rapport qualité des soins- qualité de vie.
A) Définition d'un centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose (CRCM)
Il s'agit d'un regroupement des compétences de nombreux corps professionnels dans les différentes disciplines concernées par la mucoviscidose pour soigner au mieux dans la continuité et dans la globalité les patients atteints de cette maladie : ·
- Pour les enfants dépistés, il s'agit du lieu où le diagnostic est confirmé puis annoncé et où le patient sera régulièrement suivi.
- Pour tous les patients, il s'agit du lieu où les choix thérapeutiques et les décisions importantes sont pris et expliqués au patient et à sa famille. ·
- Pour tous les intervenants et soignants, quels que soient les lieux de réalisation des soins, il s'agit du lieu de coordination des soins.
Pour permettre ce suivi et cette coordination et pour détecter les signes cliniques précoces des nouveaux dépistés, le patient doit y être suivi au moins 4 fois par an (définition de la " file active " : nombre de patients suivis au moins quatre fois par an dans le centre).
Pour pouvoir faire état d'un bon savoir-faire, la " file active "a été fixée à cinquante patients minimum par centre.
Toutefois, certains centres pédiatriques, qui suivent actuellement entre 30 et 50 patients peuvent être retenus dans une période transitoire de 5 ans à partir de la mise en place du dépistage dans leur région.
A terme, ce dépistage et le regroupement des files actives de certains services actuels doivent leur permettre d'atteindre les 50 patients suivis, dans ce délai.
Enfin, compte tenu de l'histoire naturelle de la maladie, il est possible de retenir aujourd'hui des centres adultes individualisés à partir de 20 patients qui seront nécessairement appelés à se développer dans l'avenir.
B) Rôle d'un centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose
Le CRCM doit s'engager à assumer les fonctions suivantes : ·
- La confirmation et l'explication du diagnostic pour les nouveaux dépistés. Il est l'interlocuteur de l'association régionale de dépistage (ARDPHE) et s'engage, pour chaque enfant qui lui est adressé, à remplir les obligations liées au programme de dépistage. Si le patient est perdu de vue ou suivi par un autre CRCM, il s'engage à en avertir l'ARDPHE. ·
- La responsabilité de la définition de la stratégie thérapeutique et d'une partie des soins. A ce titre, il s'engage à mettre en œuvre les recommandations nationales validées, en les adaptant à chaque patient et famille. Il s'organise pour permettre une réponse appropriée aux problèmes médicaux des patients 24h sur 24h tous les jours de l'année. ·
- La responsabilité de la coordination des soins avec les différents intervenants sanitaires et sociaux.Le CRCM a la responsabilité de la coordination de tous les intervenants et soignants quel que soit le lieu de réalisation des soins. Il doit s'assurer de la bonne mise en œuvre des décisions qui y ont été prises, de la bonne complémentarité des actions des différents intervenants au domicile et de l'adéquation des soins aux attentes et aux capacités des patients et de leur famille.Dans ce cadre, il assure l'animation et la coordination du réseau intra régional, régional voire interrégional qui lui est rattaché. Il élabore, en concertation avec l'ensemble des acteurs, la convention constitutive du réseau de soins qui doit être agréée par le directeur de l'ARH et établit un rapport annuel d'activité qui doit pouvoir être consulté par tous les partenaires. ·
- L'organisation pour les centres pédiatriques, du transfert dans les meilleures conditions aux équipes d'adultes.Les centres pédiatriques doivent s'engager à instaurer des liens de collaboration et de travail privilégiés avec une ou plusieurs équipes d'adultes et inversement. ·
- L'éducation thérapeutique du patient et de sa famille c'est à dire l'information adaptée au patient et à sa famille sur la maladie et sur les traitements. Celle-ci est une partie intégrante de la prise en charge tout comme le soutien aux familles et l'évaluation de leur capacité à assumer les traitements. Ces éléments de la prise en charge sont aussi à envisager au domicile et doivent être développés sans exclure des collaborations extérieures, comme celles venant du milieu associatif ou des réflexions particulières sur le concept d'infirmière de liaison, capable de se déplacer au domicile. ·
- La formation pratique des différents intervenants locaux, en particulier des paramédicaux ( infirmière libérales, kinésithérapeutes….) ·
- La formation initiale et continue des professionnels de santé concernés. Celle ci peut prendre des formes multiples : participation à des congrès nationaux et internationaux, publications dans des revues scientifiques, séances d'information… ·
- Une activité de recherche par l'élaboration ou la participation à des protocoles de recherche clinique et en soins infirmiers. ·
La mise en place d'une démarche d'évaluation de l'ensemble de l'organisation. Elle doit être conçue dès la mise en place du réseau rattaché au CRCM et impliquer tous les acteurs, patients et familles compris.
C) Structure et organisation du CRCM
Il ne peut exister qu'un CRCM pédiatrique et un CRCM pour patients adultes par site hospitalier volontaire.
L'hôpital qui s'engage à ce titre doit pouvoir offrir :
- une structure · ouverte toute l'année, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.Il peut s'agir d'une unité fonctionnelle, d'un service ou d'un regroupement de compétences au sein d'un service. Il n'y a pas de spécialité obligatoire en dehors de la pédiatrie pour les enfants. ·
- permettant tous les modes de prise en charge : hospitalisation à temps complet si possible en chambre individuelle, hospitalisation de jour, consultations ·
- disposant d'un agrément sanitaire MCO ou SSR, publique ou participant au service public
Les locaux doivent être adaptés en conséquence. En particulier, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter la transmission de germes entre patients.
L'hôpital peut mettre en commun des moyens dédiés à la prise en charge des enfants et des adultes. une équipe pluridisciplinaire
Elle est composée au minimum des trois compétences suivantes : médicale, infirmière et kinésithérapeute.
Dans ces 3 domaines, une permanence des réponses doit être organisée.
C'est pourquoi, il paraît utile de préciser que le CRCM doit pouvoir faire état au minimum :
- d'un équivalent temps plein médical correspondant obligatoirement à deux médecins seniors référents pour la mucoviscidose qui doivent avoir un statut hospitalier temps plein et dont l'un est le responsable du centre. ·
- d'un équivalent temps plein d' infirmier(e) coordinateur(trice) dévolu à la mucoviscidose dont il faut souligner le rôle essentiel dans la coordination des soins et l'accueil des familles. ·
- d' un équivalent temps plein de kinésithérapeute spécialisé. Les professionnels suivants : diététicienne, psychologue, assistante sociale jouent un rôle très important dans la prise en charge et leur temps de présence dans le centre doit être adapté aux besoins et au nombre de patients.
Leur activité indispensable doit pouvoir être facilement identifiable.
Par ailleurs, le CRCM doit pouvoir faire état de collaborations précises avec des spécialités diverses : diabétologie, nutrition, ORL, hépatologie
Un généticien clinicien doit assurer les consultations de conseil génétique des familles des enfants atteints dans le délai que l'équipe du CRCM juge nécessaire mais aussi celles des hétérozygotes repérés par le dépistage. Ce généticien clinicien peut ne pas faire partie de l'équipe pluridisciplinaire du CRCM mais il doit pouvoir être clairement identifié comme référent par celui-ci.
un plateau technique
Il doit permettre de réaliser les examens suivants :
Sur place :
- test de la sueur par une technique de référence, ·
- explorations fonctionnelles respiratoires adaptées à l'âge des patients, ·
- explorations fonctionnelles digestives, ·
- radiographie conventionnelle et échographie, ·
laboratoire de bactériologie habilité à l'identification et la quantification de certains germes sur milieux sélectifs, à la réalisation d'antibiogrammes et à la traçabilité des bactéries multirésistantes en lien avec le CLIN ·
laboratoires permettant la réalisation des examens courants 24h sur 24. ·
Les examens suivants peuvent être traités à l'extérieur du centre : ·
- Tomodensitométrie et scintigraphie, ·
- Endoscopies bronchiques et digestives
D) Le réseau de prise en charge des patients atteints de mucoviscidose
La formalisation d'un réseau de prise en charge est indispensable et ne doit pas être qu'un simple exercice d'écriture.
Effectivement, le réseau va conditionner en très grande partie, la réussite de la prise en charge par sa capacité à coordonner les différents intervenants. Le réseau peut être intra régional, régional ou interrégional selon qu'un ou plusieurs CRCM existent dans une région et souhaitent travailler ensemble.
Le réseau devra distinguer plusieurs lieux et niveaux de prise en charge : celui du CRCM, celui d'un éventuel centre relais ou centre de proximité et celui du domicile.
La majorité des traitements auront cependant lieu à domicile aussi deux types de coordination devront être particulièrement bien explicités : coordination entre les décisions de CRCM et leur application, et coordination des différents intervenants sanitaires et sociaux au domicile du patient.
La place éventuelle des associations de patients, doit être précisée. Le réseau s'attachera également à réfléchir aux modalités de mise en place au domicile d'une fonction de vigilance qui pourrait être assurée par le kinésithérapeute du fait de son passage quasi quotidien auprès des familles et qui doit permettre d'alerter rapidement, en cas d'aggravation, l'infirmièr(e) coordinatrice pour éviter d'éventuels retards dans la mise en place des mesures nécessaires.
Par référence à la circulaire DGS/DAS/DH/DSS/DIRMI n° 99-648 du 25 novembre 1999 relative aux réseaux de soins, le projet de réseau de soins doit nécessairement comporter, en plus des précisions sur ses objectifs, son champ d'action et son organisation interne, ·
la liste des différents acteurs,
les références aux protocoles de soins communs et les règles de bonne pratique que les adhérents s'engagent à respecter, ·
les modalités de la circulation du dossier de soins et des différentes informations concernant le patient, ·
le fonctionnement de la coordination et de l'animation du réseau : chaque réseau devra définir s'il confie la coordination au responsable du CRCM ou à un autre membre du réseau.De même, les fonctions d'animation et de coordination peuvent être dissociées de la coordination des soins dans le CRCM. La fonction de coordinateur suppose d'être l'interlocuteur privilégié des autorités de santé, ARH, DRASS/DDASS, et URCAM ·
les liens avec l'association régionale de dépistage (ARDPHE) · les moyens mis en place pour le suivi et l'évaluation du réseau. Il semble utile de rappeler l'existence du document de l'ANAES publié en août 99 sur les principes d'évaluation des réseaux de santé, accessible sur le site internet de l'ANAES (http://www.anaes.fr) et le guide " credes image " accessible sur le site du CREDES (http://www.credes.fr) ·
les différents moyens dont disposent le réseau et les cofinancements éventuels
Les modalités de mesure de l'activité du réseau qui peuvent conditionner certains financements devront faire l'objet d'une discussion spécifique entre l'établissement auquel il est rattaché et l'ARH. Certains réseaux pourront comprendre plusieurs établissements et se définiront alors selon l'article L. 6121-5 du code de la santé publique.
La convention constitutive du réseau selon les termes de la circulaire DH/EO/97 du 9 avril 1997 relative aux réseaux et aux communautés d'établissements sera portée à la connaissance de l'ARH qui l'agréera.
Le délai nécessaire à la mise en place complète d'un réseau ne doit pas être un facteur bloquant pour la désignation du CRCM et la mise en place du dépistage mais une évaluation doit obligatoirement être prévue au bout d'un an de fonctionnement pour vérifier la réalité de cette mise en œuvre.
IV. Modalités de mise en œuvre et calendrier
A partir de la date de cette circulaire , les ARH avec l'appui des DRASS et des DDASS ont jusqu'à la fin de l'année 2001 pour faire parvenir leurs propositions. Celles-ci sont à adresser au bureau O1 de la DHOS du ministère de la santé, 8 avenue de Ségur 75350 Paris 07 SP. Chaque dossier comportera : ·
- l'identification de l'équipe et ses coordonnées. ·
- le cahier des charges du CRCM et du réseau (à défaut, le projet) qui doit répondre aux exigences listées dans les points A,B ,C, D de cette circulaire. ·
- la délibération de la CME et du CA. ·
- l'avis de la DRASS et de l'ARH. La DHOS validera les différents dossiers et le dépistage systématique pourra débuter dès qu'au moins un centre CRCM aura été identifié dans une région.
Des demandes de moyens validés pourront être adressées à l'appui de ces dossiers. Elles seront honorées après avis de l'ARH, dans le cadre d'une enveloppe nationale fléchée de 4,570 M€ (30 MF) qui sera reconduite sur 3 ans à partir de 2002.
Dans les 5 ans qui suivent la mise en place du dépistage dans une région, une évaluation précise du ou des CRCM devra être menée et les centres qui suivront moins de 50 patients pour les enfants et moins de 30 patients pour les adultes ne pourront plus être considérés comme CRCM.
V. Par ailleurs, un soutien financier a été décidé pour les laboratoires de référence de biologie moléculaire sur la mucoviscidose, en dehors du cadre du dépistage néonatal relatif à des mutations fréquentes.
Le dépistage néonatal est financé par le Fonds National de Prévention, d'Education et d'Information à la Santé (FNPEIS) de la CNAM.
Par ailleurs, un soutien financier exceptionnel de 1,220 Millions d'€ (8 MF) est prévu en 2001 pour un certain nombre de laboratoires de biologie moléculaire, autorisés à pratiquer le diagnostic prénatal et amenés à effectuer des analyses qui sortent du cadre des examens de routine :
- recherche de mutations rares ·
- analyse totale des régions codantes ·
- étude de microsatellites ·
- expertise dans l'étude du gène CFTR ·
- ou autres études spécifiques
Ces laboratoires devront répondre à un certain nombre de critères stricts sur les contrôles de qualité, leur aptitude à prendre en charge la formation des personnels et leurs niveaux de publications.Ce soutien doit permettre la mise en place d'un réseau de laboratoires de biologie moléculaire travaillant sur la génétique de la mucoviscidose et référents dans ce domaine.
Signé : le Ministre délégué à la Santé